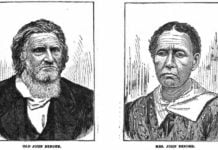Le changement écologique dramatique sur l’île de Pâques (Rapa Nui) est un cas d’étude fréquent en matière de changement environnemental, mais des recherches récentes clarifient le rôle des rats polynésiens ( Rattus exulans ) dans sa déforestation. Une nouvelle étude suggère que ces rats, introduits par les premiers colons polynésiens, ont joué un rôle clé dans la destruction des forêts de palmiers de l’île entre 1 200 et 1 650 de notre ère, parallèlement à l’activité humaine.
La forêt de palmiers et les premiers colons
Avant l’arrivée de l’homme, Rapa Nui était dominée par les palmiers Paschalococos disperta, aujourd’hui éteints mais apparentés au palmier à vin chilien. Ces arbres à croissance lente ont mis des décennies à mûrir et à porter leurs fruits, ce qui les rend vulnérables aux perturbations. Lorsque les Polynésiens se sont installés sur l’île vers 1200 CE, ils ont apporté leur matériel de subsistance standard : taro, patates douces, bananes, ignames, bétail (chiens, poulets, porcs) et le rat polynésien.
Contrairement au rat surmulot arrivé plus tard, cette espèce prospérait dans la canopée des arbres et sa présence était presque inévitable lors des voyages polynésiens. Certains récits suggèrent que ces rats ont été délibérément transportés comme source de nourriture – les preuves incluent des rapports historiques selon lesquels des insulaires les transportaient pour les consommer.
L’explosion du rat et l’effondrement du palmier
Une fois établie à Rapa Nui, la population de rats a explosé. L’île offrait des conditions idéales : pas de prédateurs naturels et une abondance de noix de palme, que les rats dévoraient sans relâche. Parce que les palmiers ont évolué sans la pression des rongeurs, leurs noix manquaient de défenses contre ce nouveau prédateur. Les rats ont consommé les graines, empêchant la régénération, tandis que les humains défrichaient les terres pour la culture de la patate douce, aggravant ainsi la déforestation.
“Les noix de palme sont des bonbons pour les rats. Les rats sont devenus fous”, a déclaré le professeur Carl Lipo de l’Université de Binghamton.
Culture sur brûlis et adaptation
Les pratiques agricoles polynésiennes, notamment la culture sur brûlis, ont également contribué aux changements environnementaux. Bien que cette méthode puisse enrichir temporairement les sols volcaniques pauvres, le faible taux de croissance des palmiers de Rapa Nui signifiait qu’ils ne pouvaient pas se rétablir assez rapidement pour résister à la prédation des rats et à l’utilisation des terres par l’homme.
Cependant, la déforestation n’était pas nécessairement un « désastre » pour les insulaires. Ils se sont adaptés en se tournant vers une culture sur paillis de pierre, qui a enrichi leurs récoltes sans dépendre des forêts de palmiers perdues. Les palmiers n’étaient pas non plus adaptés à la production de bois d’œuvre, ce qui signifie que leur perte n’a pas paralysé leur survie.
Conséquences à long terme et perspectives modernes
L’histoire ne s’arrête pas à la déforestation initiale. Le contact européen a amené l’élevage de moutons au 19e siècle, ce qui a probablement fait disparaître tous les plants de palmiers restants. Ironiquement, les rats polynésiens eux-mêmes ont ensuite été supplantés par les rats surmulots ou tués par des prédateurs introduits sur de nombreuses îles.
Les leçons de Rapa Nui sont complexes. L’histoire met en lumière les conséquences involontaires des perturbations écologiques, mais démontre également l’adaptabilité humaine face aux changements environnementaux. Comme le conclut le professeur Lipo, la refonte de l’environnement n’est pas automatiquement synonyme de résultats non durables.
Les résultats, publiés dans le Journal of Archaeological Science, renforcent l’idée selon laquelle une compréhension nuancée est cruciale lors de l’évaluation des changements environnementaux, reconnaissant les humains comme un élément naturel de la refonte du monde à leur bénéfice.